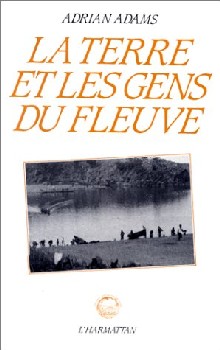Adrian Adams (1945-2000)
Texte intégral
Adrian Adams est morte le 2 août dernier dans un accident de voiture, non loin de Kungani, alors qu’elle allait à Dakar présenter son dernier écrit : Quel avenir pour la vallée ? Le lendemain, de toute la vallée du fleuve Sénégal, les Soninké sont venus en foule rendre un dernier hommage à celle qui leur léguait à la fois son message et sa vie.
Elle est morte au moment où ses idées sur le « développement paysan » obtenaient enfin une audience officielle, alors que, pendant de longues années, la conception dirigiste du « développement administratif » avait multiplié les fonctionnaires pour encadrer les paysans jugés trop ignorants. La terre avait été nationalisée ; le droit foncier local était méconnu ; à défaut de cadastre, il a fallu qu’Adrian Adams dresse le parcellaire des environs de Kungani. Une société d’État chargée des grands travaux distribuait aux paysans des « parcelles individuelles » sans tenir compte des structures sociales liées à l’occupation du sol. Cette institution amenait les cultivateurs à se couvrir de dettes pour payer engrais et semences dont elle était le fournisseur au service d’un plan qui imposait la culture du riz et autres produits destinés à l’alimentation des villes sans se préoccuper des cultures vivrières dont se nourrissaient les villageois, de sorte que l’asservissement par la dette devenait le seul avenir promis à une population composée de vieux et d’enfants sans père, car une forte émigration économique avait conduit beaucoup d’hommes en France.
Le village n’avait pas d’institution municipale semblable à celle que connaissent depuis plusieurs siècles les communes d’Europe. D’après la loi sénégalaise sur le régime domanial, l’État garde la maîtrise du foncier, ce qui facilite la conception étatique du développement.
Développer quoi et pour qui ? demandait Adrian Adams. Pendant des années, elle fut politiquement suspecte, accusée d’hostilité au gouvernement, alors qu’elle n’avait aucune préoccupation de ce genre. Elle voulait seulement attirer l’attention des autorités sur une évidence : « Il y a des gens vivant ici. » « Il y a ici des gens vivants. » Au cours des dernières années, le gouvernement sénégalais a redécouvert l’existence de ce qui fut longtemps nommé « l’économie informelle » ou populaire, celle que pratiquaient au jour le jour ces mêmes gens. On lui reconnaît aujourd’hui une existence légale. C’est ce que souhaitaient Adrian Adams et Jaabe Sow (Diabé Sow), le fondateur de la Fédération paysanne dont il sera question plus loin. C’est de là qu’il fallait partir pour aller plus avant ; il fallait d’abord aider les villageois à devenir les acteurs de leur propre développement.
Le problème n’était pas seulement économique. Et, par exemple, les instituteurs qui avaient été nommés à Kungani (Kounghany) ne comprenaient pas le soninké. Les enfants apprenaient par coeur des formules en français. À la fin de leurs études ils pouvaient lire le journal sans en comprendre un mot. Ainsi, dans tous les domaines — intellectuel, moral, économique — le présent était vide. Entre des coutumes ancestrales qui se désagrègent et un avenir de prolétaires administrés, il n’y avait pour les Soninké qu’un présent désaffecté, un fait brut et sans âme.
La réalité quotidienne était désavouée, et il ne faut pas s’étonner que cette réalité vivante désavoue à son tour les discours savants que l’on pouvait tenir sur elle. La tragédie du désaveu mutuel entre les paysans et les fonctionnaires, entre les illettrés et les lettrés, est ce qu’Adrian Adams a dénoncé dans toute son oeuvre. Les paysans savaient que leurs paroles étaient vaines, car seul l’écrit fait autorité aux yeux d’un État lointain. L’écriture était l’instrument du pouvoir. Et si Adrian Adams a écrit, c’est pour qu’une existence de droit fût reconnue aux villageois, l’écriture étant le seul moyen d’affirmer le droit des gens. Là se trouve le sens le plus profond, le plus humain, et le moins bien compris de l’oeuvre d’Adrian Adams. Serai-je capable de faire entendre cela, qui fut sa raison de vivre et de mourir ?
Adrian approchait de sa vingtième année lorsque je l’ai connue. Elle commençait à Dakar ses études universitaires en philosophie. C’est au cours de cette période qu’en toute clarté de conscience elle décida de consacrer sa vie à l’Afrique. Intelligente et douce, elle avait une volonté de fer ; elle était l’un de ces êtres qui donnent l’impression de choisir leur destin, non de le subir. Elle est née à New York le 30 novembre 1945. Son père, diplomate, avait occupé divers postes en Allemagne et en France, de sorte que la jeune Adrian avait appris à s’exprimer dans les trois langues. Après avoir obtenu son doctorat à la London School of Economics, elle fut chargée d’enseigner l’anthropologie à l’Université d’Aberdeen, dans l’Écosse qu’elle aimait parce qu’elle y retrouvait le mélange de romantisme et de bon sens qu’elle devait célébrer plus tard chez le voyageur écossais Mungo Park.
Quand elle prit son poste à Aberdeen en 1973, elle obtint une bourse du Social Research Council pour étudier la vallée du fleuve Sénégal. Au cours de plusieurs séjours successifs à Kungani (Kounghany), elle rencontra Jaabe Sow, qui animait alors les travaux agricoles qu’elle était venue étudier. Adrian Adams et Jaabe Sow étaient de même trempe. Ils se reconnurent. En 1977, Adrian décida de renoncer à sa carrière universitaire pour devenir la troisième épouse de cet homme intelligent, créatif et généreux. L’Université d’Aberdeen fit savoir qu’elle pourrait reprendre son poste quand elle le voudrait. Cependant elle déclarait : « Jamais je ne me suis sentie aussi pleinement réconciliée avec moi-même. » Et c’est ainsi que, pour toujours, elle devint Soninké.
La même année (1977), elle publiait chez Maspero Le long voyage des gens du fleuve. Après avoir rappelé brièvement l’histoire des Soninké, Adrian étudie la situation présente en insistant sur deux points :
- La forte émigration des jeunes en France. Jusqu’en 1963-1964, les migrants vont travailler quelques années en France pour envoyer de l’argent au pays, puis reviennent et sont remplacés par d’autres. Ensuite, et surtout à partir de 1970, l’émigration est réglementée ; il n’est plus possible d’aller et venir librement. Le séjour des travailleurs en France se stabilise. Il en résulte que la population locale manque de bras, et que, dans les familles, les pères sont absents.
- L’initiative paysanne pour le développement des cultures irriguées. Pendant la guerre, Jaabe Sow avait fait son service dans la marine française. Il avait profité de ses permissions pour aller dans l’arrière-pays provençal se renseigner sur la pratique des cultures irriguées. À son retour au pays, il ramène une pompe hydraulique et un technicien qu’il avait embauché pour enseigner aux Soninké les techniques d’irrigation. L’entreprise de Jaabe Sow réussit ; les paysans sont convaincus. En 1975, dix-neuf villages 1 se regroupent dans une Fédération des paysans organisés en zone soninké.
Ainsi, les paysans sont déjà organisés lorsqu’arrive dans le pays la société d’État (Société d’aménagement et de développement (SAED) chargée de l’aménagement du fleuve. Alors commencent des années de conflit et d’incompréhension totale entre paysans et fonctionnaires. Les paysans veulent bien être aidés par cette société, mais refusent de renoncer à leur organisation et à une part indispensable de cultures vivrières. La SAED enlève aux paysans leur technicien auquel elle offre une situation plus avantageuse en ville. Le gouvernement refuse de reconnaître la Fédération agricole, lui prêtant des intentions politiques qu’elle n’avait pas. Les Wolofs se méprennent totalement sur la nature de l’organisation soninké.
Les villages soninké du Gadiaga sont composés de concessions familiales assez importantes. Pour chaque concession, la coutume a établi un parallélisme entre le système de production et le système de consommation. La double exploitation de champs collectifs et de parcelles individuelles (masculines ou féminines) fournit dans chaque famille des ressources complémentaires. La conception paysanne du développement s’est construite à partir de cette tradition. Pour financer les cultures irriguées, les parcelles individuelles ne suffisaient pas. La Fédération a trouvé une solution très simple : il a suffi de transformer le champ collectif familial en champ collectif villageois. Sur cette base, il devenait possible d’acheter engrais, semences et matériel agricole. La création d’un atelier de mécanique pour l’entretien de ce matériel fut également financé par la Fédération ; pour cela elle avait même payé à un apprenti mécanicien un an de formation à Dakar. En somme, il avait suffi de modifier la coutume sur un seul point pour l’adapter à la maîtrise de techniques nouvelles et pour accroître la commercialisation sur le marché régional.
La SAED aurait pu se réjouir de cette innovation efficace ; elle aurait pu la prendre comme base de départ en élargissant ses capacités productives. Il aurait fallu pour cela qu’elle modifie la rigidité du plan pour l’adapter aux souplesses de la vie. Mais c’est justement cela qui lui était impossible. Dans l’entreprise des paysans elle ne vit qu’un obstacle, une déviation « gauchiste ». Et cependant, malgré les multiples tracasseries administratives, la Fédération a continué à agir jusqu’aujourd’hui. Elle a même eu des imitateurs jusqu’en Casamance. On pourrait objecter que ces entreprises villageoises ne suffisent pas à résoudre les problèmes de l’économie sénégalaise. Cela est vrai à court terme. Néanmoins un pas décisif a été fait : des bases coutumières de la société avait surgi l’esprit d’entreprise. Cela, nul n’aurait pu l’inventer sinon les intéressés eux-mêmes.
Dans le même temps, Adrian se consacrait à l’alphabétisation des gens dans la langue soninké, elle rédigea pour cela un manuel utilisant le bilinguisme comme outil pédagogique ; elle aidait les associations féminines dans leurs multiples fonctions, éducatrices et matérielles. En plus de ces tâches quotidiennes, elle trouva le temps d’écrire des articles, de donner des entretiens télévisés à la BBC, et même de faire un film.
En 1980, Adrian publia la préface de la traduction de Mungo Park : Voyage à l’intérieur de l’Afrique. L’année précédente (3 septembre 1979), elle m’écrivait :
« J’aime beaucoup le livre de Park, Écossais qui traversa à la fin du XVIIIe siècle ce pays où je vis. Contrairement aux poncifs dont l’entoure une littérature anglaise assez terne, il me semble tout le contraire d’un précurseur de l’épopée coloniale. Un météore, le bref miracle d’un regard libre et neuf sur une Afrique souveraine, d’une rencontre de plain-pied tragiquement, inévitablement annulée par son second voyage où il meurt comme le Kurtz de Conrad, mais dont son premier voyage conserve le souvenir inaltéré. Bien dire ce que je veux dire pour rendre le récit de Park accessible aux lecteurs africains me demande beaucoup de travail. C’est une grande joie de retrouver chaque jour, parmi une vie familiale heureuse et sereine, un travail qui exige de soi le meilleur. »
Dans la même lettre, elle m’annonçait que son jeune frère, André, venait de mourir au mois de juin.
En 1983, Adrian nous envoyait le manuscrit d’un livre « inclassifiable », disait-elle. Il avait pour titre : La terre et les gens du fleuve. Maspero refusa de l’éditer. Il fut accepté finalement aux éditions L’Harmattan (1985) grâce à l’obligeance de leur directeur, Denis Pryen. Je trouvais que le livre était mal composé. Et de fait, Adrian entreprit une nouvelle composition, plus claire et beaucoup plus complète qui parut onze ans plus tard à Oxford sous le tire : A Claim to Land by the River. A Household in Senegal, 1720-1994. L’édition anglaise est signée d’Adrian Adams et de Jaabé Sow, pour bien faire savoir qu’il n’est pas écrit seulement sur les Soninké mais par des Soninké. La double signature explique ce qui demeurait implicite et déroutant dans le livre en français. Pourtant c’est à cette version qu’il faut toujours revenir comme à la source de l’inspiration première. Rien ne remplacera jamais ce poème scellé qui s’intitule La terre et les gens du fleuve. C’est un secret d’amour recouvert par le « Septième Sceau » comme il est dit dans le film d’Ingmar Bergman. La première partie du livre est le Septième Sceau. Ne cherchez pas d’emblée à le briser. Laissez-le en attente. Lisez d’abord la seconde partie. Là, tout est clair. C’est Jaabe qui parle, il discute avec les fonctionnaires, les experts, les docteurs en développement technocratique.
Les paroles et les écrits des protagonistes sont cités, références à l’appui. Adrian s’efface devant les personnages qu’elle laisse parler. L’effet est surréaliste. Il suffit de connaître tant soit peu la situation réelle pour voir que tous les personnages évoluent sur un théâtre complètement irréel. Le cynisme parfois, mais surtout l’incompréhension est stupéfiante. Nous assistons à la tragédie du désaveu, que j’évoquais plus haut. Les personnages parlent. Il suffit de les écouter, il n’y a rien à ajouter. L’absurde envahit la scène. L’abstraction du développement se développe. En politique, il est difficile de savoir si l’on rêve ou non.
Vous pouvez lire maintenant la première partie. Là, plus de tragédie. Il n’est plus question du développement se désavouant lui-même. On n’entend plus aucun bourdonnement. Tout est devenu intérieur. Le long d’un fleuve, entre deux déserts, le Sahara au nord et au sud le Ferlo, un marcheur solitaire, qui pourrait être vous-même, s’avance à la rencontre improbable des vivants, femmes et hommes oubliés sur une terre exaspérée de soleil. Soyez patients sur le sable. Écoutez les premières phrases du livre :
« La chaleur ces derniers mois aura été une fièvre qui ne s’apaise qu’au petit matin… Tu entres dans la ville avant l’aube par le chemin qui vient de l’aval. De loin déjà tu vois la barre basse et sombre des premiers murs, la lueur mate des toits de métal. À ta gauche brille le fleuve immobile au plus bas de son lit profond ; à ta droite s’étale la terre proche dure et nue entre de maigres arbustes, plus loin revêtue d’une touffeur brumeuse jusqu’à l’horizon que soulève une longue colline. Tu marches lentement. À cette heure le ciel éclaire la terre… douce aux pas dont elle éteint le bruit… Tout ce qui se dresse devant toi est sombre : de part et d’autre du chemin les palissades de bois fendu qui ceignent des terrains neufs ; à l’orée de la ville ce grand arbre au tronc puissant, aux larges feuilles rigides ; et les murs qui enserrent l’étroite coulée claire du chemin, à ta gauche un grand mur lisse percé de petites fenêtres closes d’où suinte une odeur d’encens, à ta droite l’argile tiède et rêche du mur d’enceinte d’une autre maison au portail clos. Tu entres bien avant dans la ville qui t’enveloppe comme un vêtement. »
Pour éviter le regard distant de l’ethnologue sans aller jusqu’au roman qui recrée l’intériorité des êtres, l’auteur a choisi la solution intermédiaire d’une voix qui s’adresse à « toi », passant infatigable, pour « te » faire venir auprès des femmes et des hommes habitant ces lieux, puis de celui (Jaabe) qui sera le personnage central de la deuxième partie. Peu à peu la voix du narrateur s’efface ; elle disparaît, on ne sait comment, pour laisser son invité en présence des choses vues et des dialogues entendus. Désormais, vous poursuivrez seul votre marche dans l’émerveillement d’un monde à chaque pas nouveau. Arrêtez votre lecture dès que vous vous sentirez pénétré par ce rythme lent qui invite à la paisible acceptation des êtres et des choses. Plus tard, vous relirez quelques pages, juste ce qu’il faut pour qu’elles vous donnent le ton. Inutile de lire d’un trait ; soyez docile à votre propre rythme. L’amour inconditionnel de ce qui existe ici et maintenant est une chose tellement singulière qu’il faudra de temps en temps ouvrir le livre n’importe où, pour retrouver le ton juste, la douceur infinie de l’acceptation.
La terre et les gens du fleuve laisse deviner la vie intérieure d’Adrian Adams dans sa marche inlassable à la rencontre des vivants.
Il fallait être poète comme Cheikh Amidou Kane pour comprendre « l’aventure ambiguë » de celle qui s’en allait chez lui mais n’arriva jamais, de sorte qu’il resta seul pour annoncer : « Gens du fleuve, gens du Sahel, gens d’Afrique, prenons le deuil : celle qui nous avait choisis vient de nous être ravie 2
Professeur émérite de l’Université de Rennes.
Adams, A.
1974 « Prisoners in Exile : Senegalese Workers in France », Race and Class, XVI (2).
1977 Le long voyage des gens du fleuve, Paris, Maspero.
1980 « Préface », in M. Park, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, Paris, Maspero : 5-27.
1985 La terre et les gens du fleuve. Jalons, balises, Paris, L’Harmattan.
1994 « Sénégal » (traduction et transcription d’entretiens avec des paysan(ne)s du Sénégal sur les évolutions du monde rural et les conséquences de la sécheresse au Sahel), in N. Cross & R. Barker, eds, Mémoires du désert : des Sahéliens se souviennent, Paris, L’Harmattan/Panos ; London, SOS Sahel Grande-Bretagne : 81-98.
2000 Fleuve Sénégal : gestion de la crue et avenir de la vallée, London, International Institute for Environment and Development (IIED, Programme zones arides, Dossier 93).
2000 Quel avenir pour la vallée ?, Dakar-London, International Institute for Environment and Development, broch., mai (également disponible en pulaar et en soninke).
Adams, A., dir.
1996 Poissons et pêches du fleuve Sénégal, FPOB Kounghany Bakel Sénégal, IIED, London, Institut Panos Paris, (également disponible en pulaar et en soninke).
1996 Étude de faisabilité d’un plan d’action pour l’agriculture de la vallée du fleuve Sénégal, rapport pour le Groupe de réflexion stratégique sur l’avenir de la vallée du Sénégal.
1997 L’agriculture de la vallée du fleuve Sénégal : hier, aujourd’hui, demain, présentation de l’étude de faisabilité d’un programme d’action pour l’agriculture de la vallée du fleuve, GRS, séminaire de restitution de N’Dioum, septembre.
Adams, A. & Sow, J.
1996 A Claim to Land by the River. A Household in Senegal, 1720-1994, Oxford, Oxford University Press.
Kourouma, A.
1981 The Suns of Independance. Translated by Adrian Adams, London-Nairobi-Ibadan, Heinemann.
Pour citer cet article
http://etudesafricaines.revues.org/document64.html
Annotations
1. Ballu, Arundu, Yafera, Golmi, Kungani, Tuabu, Manaël, Yelingara, Diawara, Muderi, Gallade, Gande, Turime, Bema, Gugnan, Gabu, Bakel, Diabal, Kadiel.
2. Le Soleil, Dakar, 14 septembre 2000.